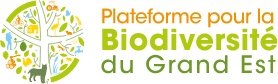« Conserver, c’est d’abord un compromis ! »
 Inventaire Kogenheim (67)
Inventaire Kogenheim (67)
Connaissance & donnéesEspèces & territoiresLIFE Biodiv’Est
Publié le 14 novembre 2025
 [Espèces & territoires – Les pelouses sableuses 2/2]
[Espèces & territoires – Les pelouses sableuses 2/2]
Chargé de mission et animateur du Plan Régional d’Actions pour la conservation des dunes continentales et de la flore des milieux sableux du Grand Est au sein du Conservatoire botanique d’Alsace-Lorraine, Nicolas Steinmetz partage sa vision de la conservation de la nature : un subtil équilibre entre activités humaines et protection, où chaque décision se prend avec les acteurs du territoire.
« Dans le climat politique actuel, on a souvent tendance à opposer, à juste titre, activités humaines et protection de l’environnement. Dans cette vision manichéenne, la conciliation des enjeux environnementaux avec les activités humaines semble alors utopique… Au fil de mes rencontres avec les différents acteurs du territoire, je me suis rendu compte que les pelouses sableuses font exception à cette règle et témoignent qu’un équilibre est possible. Elles m’ont poussé à revoir mes idées en matière de gestion des végétations et, in fine, ma vision de la conservation de la nature.
« Bien comprendre les facteurs permettant la conservation des pelouses sableuses »
Il est important de bien comprendre les facteurs permettant la conservation des pelouses sableuses. Elles ont nécessairement besoin d’un niveau de perturbation minimal des sols (naturelle ou anthropique) afin de limiter la colonisation des espèces les plus compétitrices (graminées prairiales, ligneux, …) et favoriser les espèces pionnières spécialisées. Néanmoins, un niveau de perturbation trop élevé dégrade voire détruit la végétation.
Par exemple, l’utilisation fréquente d’une piste par des engins (motocross, véhicule tout-terrain, …) voire de randonneurs provoque des problèmes de piétinement dégradant la végétation. Toutefois, en l’absence de ces facteurs anthropiques, la dynamique de végétation irait fatalement vers la fermeture du milieu.
Pelouses sableuses subsistant dans une ancienne piste © Nicolas Steinmetz
Selon la doctrine initiale, deux choix s’offrent alors à nous :
1 -> Fermer l’accès complet au public, mais la végétation continuera inexorablement sont avancée, exigeant des gestionnaires un niveau d’investissement important tant humain que financier
2 – > Ne pas intervenir, et la végétation finira par être détruite par le piétinement
L’une ou l’autre des solutions ne paraît pas satisfaisante car un parti se retrouverait automatiquement lésé.
« Savoir positionner le curseur »
Ce constat étant établi, on comprend très vite que la protection de l’environnement ne se présente plus comme une mise sous cloche de la nature, un arrêt total des activités humaines, mais plutôt comme une politique avec ces nuances.
Reprenons l’exemple de la piste : plutôt que de choisir entre une fermeture totale ou un laisser-faire, pourquoi ne pas en moduler l’accès ? Cela pourrait passer par des restrictions en fréquence (réserver son usage à certains usagers, alterner les saisons d’ouverture avec d’autres pistes) ou en intensité (interdire les engins lourds, limiter la vitesse, privilégier les passages piétons, baliser strictement le tracé, etc.). Ces mesures, bien sûr, doivent être ajustées en fonction des réalités locales et des attentes de chaque partie prenante, pour aboutir à une solution acceptable par tous.
Au fond, la conservation de la nature repose sur ce principe : savoir positionner le curseur entre protection totale et liberté d’usage, au regard des enjeux patrimoniaux et réglementaires. »
✨ A Relire : Les pelouses sableuses, trésors cachés du Grand Est