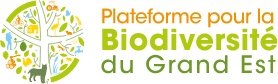Les indicateurs de l’OGEB

Des outils pour passer à l’action, que vous soyez décideur ou citoyen !
L’OGEB se structure autour d’un cadre de référence organisé en 20 thématiques qui correspondent aux milieux observés dans la Région Grand Est, aux pressions auxquelles est confrontée la biodiversité et aux solutions envisagées. Ces thématiques se déclinent ensuite en des questions évaluatives sur lesquelles l’Observatoire doit apporter des éléments de réponse grâce à des indicateurs.
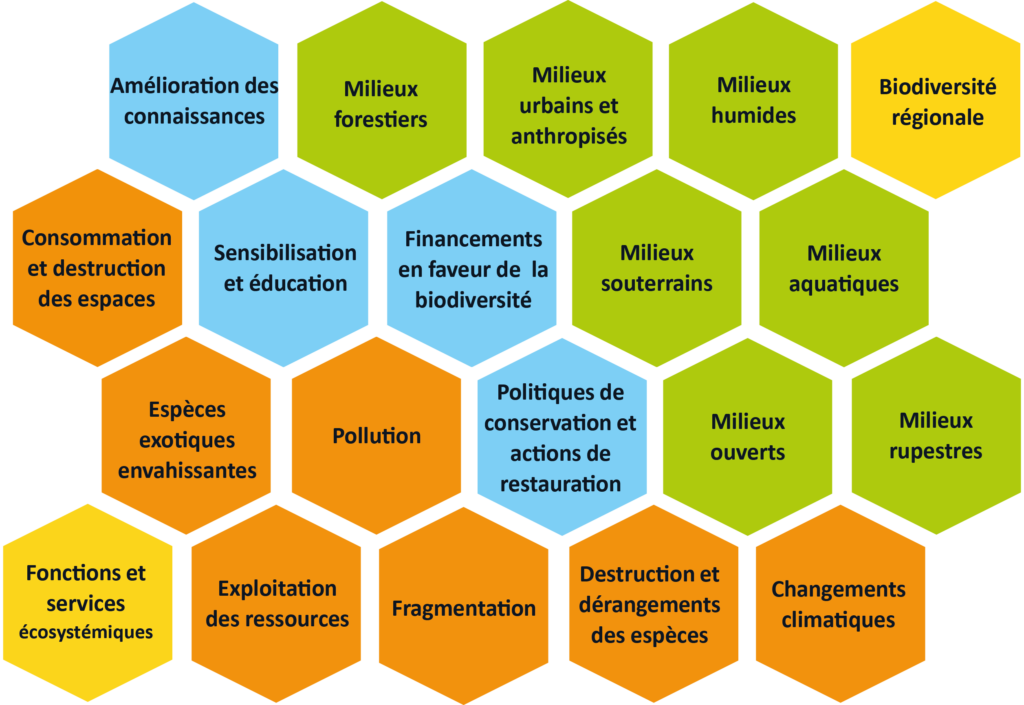
Qu’est-ce qu’un indicateur ?
« Un indicateur de biodiversité est une mesure, généralement quantitative, qui peut être utilisée pour illustrer et faire connaître de façon simple des phénomènes complexes relatifs à la biodiversité, y compris des tendances et des progrès dans le temps ».
Les indicateurs ne se suffisent pas à eux-mêmes : ils doivent être contextualisés et accompagnés d’une interprétation adéquate.
Ce sont des outils d’évaluation et d’aide à la décision grâce auxquels on va pouvoir mesurer une situation ou une évolution, à un instant donné, de façon objective et synthétique.
Deux outils : les indicateurs statistiques et les descripteurs
Les indicateurs statistiques de suivi de la biodiversité sont basés sur des protocole scientifiques robustes.
Les descripteurs sont élaborés à partir de données opportunistes issues d’observations naturalistes, de durées, d’espaces, et de méthodologies d’identification hétérogène.
Les indicateurs sont développés selon le modèle « Etat ; Pression ; Réponse » :
> Les indicateurs d’état doivent permettre d’évaluer l’état de la biodiversité et des milieux naturels ;
> Les indicateurs de pression doivent permettre de mesurer les pressions exercées sur les milieux naturels et la biodiversité ;
> Les indicateurs de réponse doivent permettre de mesurer les actions mises en œuvre en faveur des milieux naturels et de la biodiversité.


Vipère Aspic © A. Farese Rousserolle turdoïde © J. Says
Fiches indicateurs statistiques
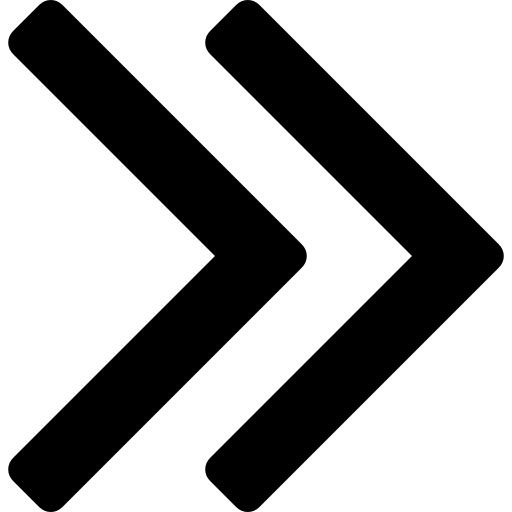 Évolution des populations d’espèces dans le Grand Est
Évolution des populations d’espèces dans le Grand Est
Places de chant de Sérotines bicolores – 2023
Cortège de chauves-souris en hibernation en milieu souterrain – 2023
Cortège d’espèces de chiroptères sensibles à la rénovation énergétique et à l’éolien – 2023
Le Sonneur à ventre jaune – 2022
Le Triton crêté – 2021
Suivi hivernal des oiseaux communs (SHOC) – 2023
Les oiseaux d’eau – 2023
Pic cendré, Pic mar et Pic noir – 2022
Le Milan royal – 2023
La Vipère aspic – 2023
Le Lézard à deux raies – 2020
Rhopalocères et zygènes – 2020
Les orthoptères – 2022
Les odonates – 2023
Fiches descripteurs
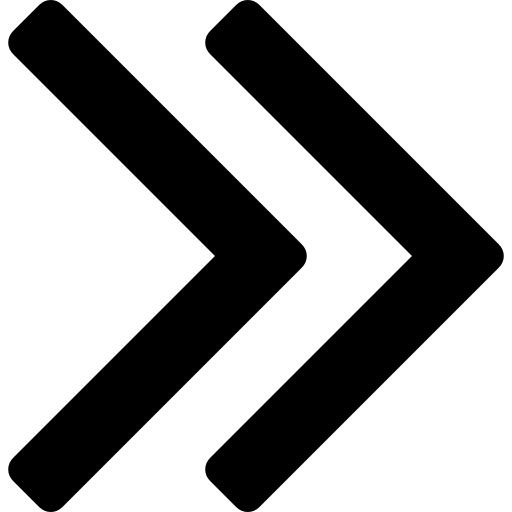 Connaissance
Connaissance
Amélioration de la connaissance taxonomique en Grand Est : les espèces nouvellement observées – 2022
Etat de la connaissance des insectes en Grand Est : les Odonates – 2021
Bases de données naturalistes faunistiques du Grand Est : collecte de données et connaissance – 2021
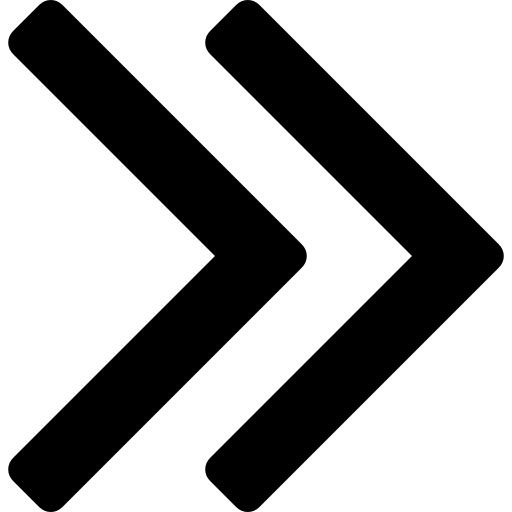 Évolution des populations d’espèces dans le Grand Est
Évolution des populations d’espèces dans le Grand Est
Le râle des genêts – 2022 Le Martinet à ventre blanc – 2022
Le Faucon pèlerin – 2023 La Grue cendrée – 2023
Le Martinet noir – 2022 Le Héron cendré – 2021
La Cigogne blanche – 2021 La Mouette rieuse – 2021
La Rousserolle turdoïde – 2021 Le Grèbe huppé – 2021
La Sterne pierregarin – 2021 Le Choucas des tours – 2023
La Chevêchette d’Europe – 2023 Le Muscardin – 2023
La Chouette de Tengmalm – 2023
Fiches méthodologiques
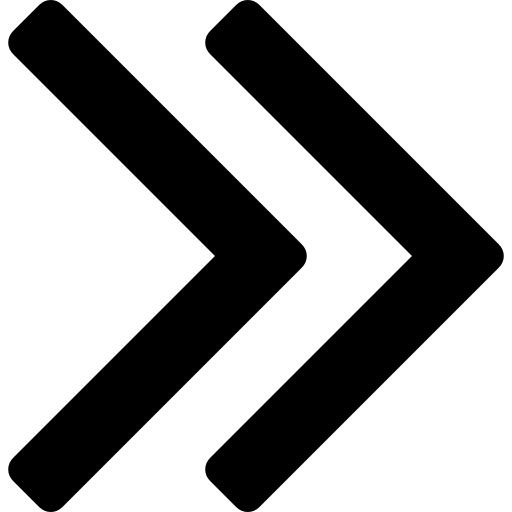 Construction indicateurs
Construction indicateurs
Superficie des haies et bosquets – 2023
Le Sonneur à ventre jaune – 2022
Le cortège de chauves-souris en milieu souterrain – 2022
Les orthoptères – 2022
Les places de chant de Sérotine bicolore Vespertilio murinus – 2022
Le Lézard à deux raies – 2020
Le Triton crêté – 2020
Les rhopalocères et les zygènes – 2020
La Vipère aspic – 2020
Le Milan royal – 2019
Les populations hivernantes d’oiseaux d’eau – 2019
Les oiseaux communs en Hiver (SHOC) – 2019
Les populations d’oiseaux communs spécialistes et généralistes (STOC) – 2019